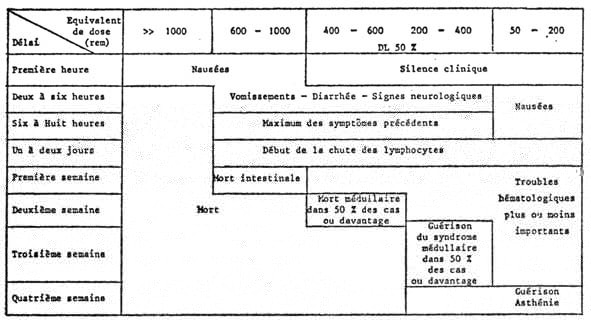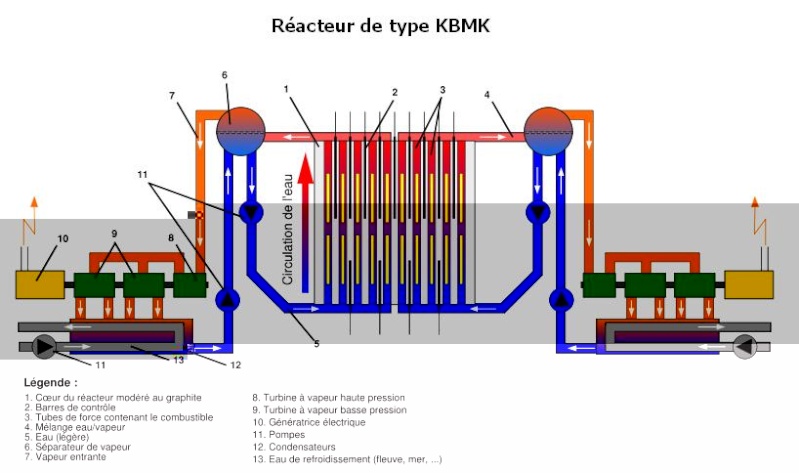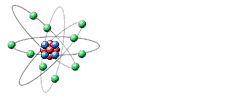Le 26 avril 1986, marque le début d'une lutte à mort contre le temps et la radioactivé. Au total plus de 700.000 personnes participeront à la bataille de Tchernobyl.
Voici l'histoire :
1. Un exercice de sécurité
Depuis sa mise en service en 1977, la centrale de Tchernobyl est dirigée par Viktor Petrovitch Brioukhanov, un ingénieur en thermodynamique et non un spécialiste du nucléaire. Il fait partie d'une génération d'hommes promus grâce à " leur volontarisme militant, qui consistait d'abord et avant tout à remplir et dépasser le plan de production, nonobstant le respect des normes de construction ou de sécurité. "
L'accident s'est produit suite à une série d'erreurs commises par les techniciens de la centrale et d'une conception non sécurisée. Les opérateurs ont notamment violé des procédures garantissant la sécurité du réacteur et donc de la centrale.
Une expérience est prévu sur le réacteur n°4, pour tester l'alimentation électrique de secours qui permet au réacteur de fonctionner en toute sécurité pendant une panne de courant. La puissance thermique du réacteur est donc réduite de 3.200 Mw* à 1.000 Mw dans le cadre de ce test dans la nuit du 25 au 26 avril.
25 avril 1986, 13:05 : La puissance du réacteur est stabilisée autour de 1.600 Mw.
23:10 : La puissance est encore abaissée à 500 Mw. Cependant, la puissance de sortie chute brutalement à 30 Mw, ce qui provoque un empoisonnement du réacteur au xénon. Les opérateurs essaient alors de rétablir la puissance, mais le xénon-135 accumulé absorbe les neutrons et limite la puissance à 200 Mw. Pour débloquer la situation, les opérateurs retirent les barres de carbure de bore, qui servent à contrôler la température du réacteur, au-delà des limites de sécurité autorisées.
La procédure normale est différente : Au moment de l'expérience, la puissance du réacteur chute jusqu'à 30 Mw et selon les lois de physique le réacteur tombe dans un " trou d'iode ". Dans cette situation il faut arrêter le réacteur, attendre 2 ou 3 jours que les isotopes d'iode à vie brève se désintègrent et que la puissance revienne à son niveau normal.
26 avril 1986, Entre 01:03 et 01:07 : Deux pompes supplémentaires du circuit de refroidissement sont enclenchées pour essayer de faire augmenter la puissance du réacteur. C'est le dernier moment pour arrêter le réacteur et le sauver.
01:19 : Pour stabiliser le débit d'eau arrivant dans les séparateurs de vapeur, la puissance des pompes est encore augmentée. Le système demande l'arrêt d'urgence. Les signaux sont bloqués et les opérateurs décident de continuer.
01:23 : L'essai réel commence. Les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine sont fermées, ce qui a fait augmenter la pression dans le circuit primaire.
01:23:40 : L'opérateur en chef ordonne l'arrêt d'urgence. Les barres de contrôle sont descendues, sans grand effet.
01:32:44 : La radiolyse de l'eau conduit à la formation d'un mélange détonnant d'hydrogène et d'oxygène. De petites explosions se produisent, éjectant les barres permettant le contrôle du réacteur. En 3 à 5 secondes, la puissance du réacteur se voit centupler. Les mille tonnes de la dalle de béton recouvrant le réacteur sont projetées en l'air et retombent de biais sur le c?ur de réacteur, qui est fracturé par le choc.
Un incendie très important se déclare, tandis qu'une lumière aux reflets bleus se dégage du trou formé.
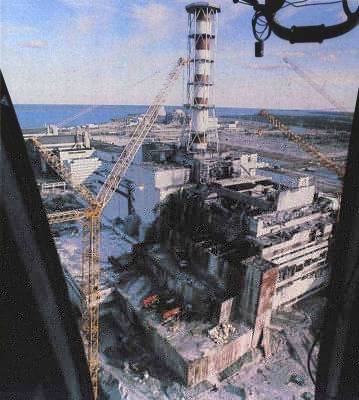
A droite de la cheminée ce trouve le bloc n°4 et à gauche le bloc n°3.
Il est à noter que les techniciens présents sur place, ainsi que Brioukhanov réveillé à 1h30, ne saisissent pas dans l'immédiat l'ampleur de la catastrophe.
Celui-ci appelle le ministère de l'énergie à 4h en déclarant que " Le c?ur du réacteur n'est probablement pas endommagé."
Déjà le nuage radioactif** commence à dériver au gré du vent.
2. Les pompiers arrivent
Afin d'éteindre l'incendie, Brioukhanov appelle tout simplement... les pompiers. La caserne de pompier de la ville Pripyat, située à 3 km de la centrale, intervient sur les lieux sans équipement particulier. Dans des conditions extrèmes, les pompiers parviennent au matin à éteindre l'incendie, mais ils sont décimés. Gravement irradiés, ils sont évacués et 31 vont mourir, pour la plupart dans des conditions atroces, les jours suivants.
Aucune photographie ne subsiste de l'incendie, la radiation ayant détruit tout les négatifs.
3. Les hélicoptères
Même si l'incendie est éteint le graphite est toujours en combustion (3400°- 3800°) et ce mélange au magma d'uranium toujours en réaction. On peut voir des rayon gamma* pur flamboyer, d'un joli bleu, dans le cratère. C'est cela qui forme le nuage de fumée saturé de particules radioactives.
Après avoir éteint l'incendie, il faut étouffer la réaction nucléaire incontrôlée. Ce n'est que par la suite que le réacteur pourra être isolé par le sarcophage.
Cette opération est réalisée à partir d'hélicoptères militaires de transport. 1000 pilotes y participeront.
Il s'agit de larguer dans le trou béant : 1.800 tonnes de sable et d'argile, de 2.400 tonnes de plomb, de 40 tonnes de bore et de borax (absorbant les neutrons), et de 600 tonnes de dolomite (relachant du Co² sensé étouffer le feu), du phosphate de sodium et un liquide contenant du polymère BU 93.

Un hélicoptère déverse des liquides sensés retenir la poussière radioactive au sol.
On a largué environ 150 tonnes de matériaux le 27 avril, puis 300 tonnes le 28 avril, 750 tonnes le 29 avril, 1.500 tonnes le 30 avril, 1.900 tonnes le 1er mai et 400 tonnes le 2 mai.
Ce mélange doit servir à stopper la réaction nucléaire. Au début le larguage était éffectué en vol stationnaire, mais l'exposition est trop importante. Sans vol stationnaire cependant, la mission est difficile, car elle revient à larguer les sacs à une hauteur de 200 m dans un trou de 10 m de diamètre environ, et le plus vite possible, car les équipages reçoivent 8.000 Röntgen/heure****, même à cette altitude.
Les hélicoptères fournis pour ces missions, sont blindés de plaques de plomb.
Au final le plomb largué rend le nuage encore plus toxique tandis que divers élements on fait office d'isolant thermique faisant encore grimper la température du c?ur endommagé. Le pic de radionucléides relachés est atteint la dernière semaine (du 2 au 9 mai) moment où le feu de graphite est enfin maitrisé.
4. Sous terre
Sous le réacteur détruit, une dalle de béton commence à fondre. Cette dalle doit normalement non seulement être utilisée pour refroidir le c?ur, mais aussi servir de barrière à la contamination des eaux souterraines par des matières radioactives fondues.
Plus grave : les 28 et 29 avril les membres du département de la physique des réacteurs de l'institut de l'énergie atomique de l'Académie des sciences de Biélorussie éffectuent des calculs qui montres que 1300 à 1400kg du mélange magma d'uranium-graphite en combustion-eau consitue une masse critique et qu'une explosion atomique d'une puissance de 3 à 5 Mégatonnes peut ce produire ( 50 à 80 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima).
Une explosion d'une telle puissance peut provoquer des radiolésions massives des habitants dans un rayon de 300 à 320 km (y compris la grande ville de Minsk) et recouvrir toute l'Europe d'une forte contamination radioactive rendant la vie normale impossible.
Le 9 mai, il est décidé de renforcer cette dalle, en creusant une galerie sous le réacteur et d'y établir un système de refroidissement incorporé.
À cet effet, il faut creuser un tunnel à partir du soubassement de la tranche 3. De l'ordre de 400 personnes ont travaillé sur ce tunnel dans des conditions de chaleur (70°) et de radiation (200R) infernales. Ces gens ne sont pas des militaires, ce sont des mineurs venu de Moscou et du bassin du Donbass. Ils se sont sacrifiés volontairement pour l'humanité même si je ne pense pas qu'ils savaient exactement à quoi ils s'exposaient. Leur temps d'exposition aux radiations a écourté la vie à la majorité d'entre eux. Le tunnel de 200 mètres est achevé et la dalle est renforcé dans l'espace de 15 jours empêchant une catastrophe qui aurais dévasté l'Europe.